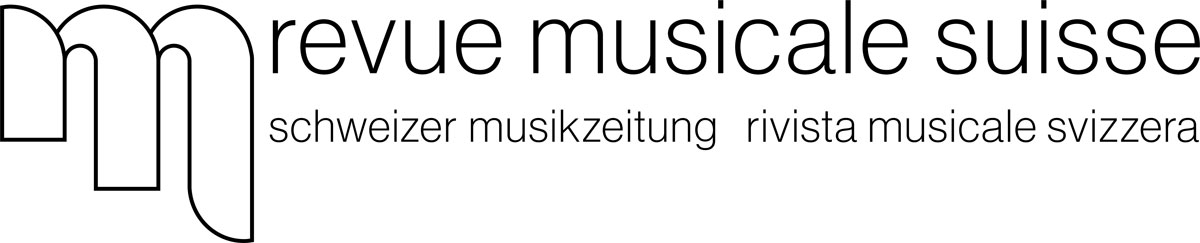Santé psychique des musiciens
Dans la précédente édition de la RMS, nous avions abordé quelques aspects de la santé physique des musiciennes et musiciens. Cet article traitera brièvement de leurs affections psychiques.
Séparer le mental et le corporel est certes pratique, mais ils se trouvent cependant souvent liés, les empêchements physiques pouvant amener à se sentir dépassé ou dévalorisé, et même se transformer en véritable dépression, raison pour laquelle il ne faudrait nullement négliger l’éventualité d’un appui psychologique dans le cadre des soins portés aux maux physiques des artistes. Ainsi que pour les pathologies corporelles, dissimuler des affections durables de l’esprit, que ce soit à soi-même (refoulement), à ses proches et amis de confiance ou aux thérapeutes, ne conduit souvent qu’à l’aggravation du problème. Après avoir subi de graves troubles musculosquelettiques, retrouver de la confiance en soi et en ses capacités ne coule pas de source. Inversement, l’état mental peut influer sur le corps et induire des réactions plus ou moins fortes selon la personne et les circonstances. Les complications gastro-intestinales semblent les plus fréquentes et présentent des problèmes pratiques compliquant les activités musicales. Une gêne respiratoire, voire de l’asthme, une tachycardie ou des dermatoses participent également de ces somatisations résultant d’un stress psychologique trop intense. Dans ces cas, les traitements ne devraient pas se cantonner uniquement aux symptômes, mais inclure aussi un accompagnement psychothérapeutique, centré en particulier sur la gestion de l’anxiété et du stress. Malgré les tabous et les clichés, il n’y a rien de honteux ou d’humiliant dans le fait d’entrer dans une telle démarche. Pour des raisons largement liées à l’image qu’ils croient devoir donner tant à eux-mêmes qu’à autrui, les hommes sont souvent moins enclins que les femmes à accepter le fait de ne pas être apte à gérer adéquatement leur mental. La crainte de donner une impression de faiblesse et les injonctions sociales (« soit un homme, soit fort, prends-toi en main ») n’encouragent pas à accepter une telle aide pourtant si utile, tout en créant un sentiment de culpabilité. Il perdure également une connotation négative, comme si toute consultation thérapeutique en lien avec la psyché devait nécessairement signifier que le patient était en proie à une grave maladie mentale.
Risques psychosociaux
Récemment, un violoncelliste concertiste français atteint de troubles bipolaires soulignait à quel point il était difficile de justifier le fait de devoir annuler des concerts pour des raisons d’ordre mental, qui demeurent invisibles contrairement à une fracture du bras ; le risque est grand d’être considéré comme une personne non fiable, à cause du manque de sensibilisation à la problématique des affections de l’esprit. Un des maux de notre siècle, le syndrome d’épuisement professionnel désigné sous le nom de burn-out, provient d’une usure progressive due à un stress chronique. Qu’il ait une cause extrinsèque (suroccupation menant à une vie privée réduite et à un manque de temps pour récupérer) ou intrinsèque (perfectionnisme, mauvaise gestion du temps ou de ses émotions négatives), le stress provoque une production d’hormones qui à la longue fatigue le corps. Un facteur potentiellement aggravant est la précarité, telle que la connaissent les artistes indépendants qui doivent multiplier les engagements pour survivre. Une sensation d’utilité et une vision satisfaisante de son métier, une atmosphère favorable et épanouissante sur le lieu de travail (école de musique ou orchestre par exemple) sont des facteurs essentiels pour éviter un burn-out, de même que l’activité physique ou le contrôle de la respiration. Actuellement encore, la prévention du burn-out s’avère insuffisante, tout comme celle des dysfonctionnements mentaux en général, en particulier de la dépression. Depuis quelques années cependant, on parle de plus en plus des risques psychosociaux (ou RPS) et de leurs conséquences néfastes, incluant entre autres une perte de motivation, un repli sur soi-même, un comportement social désagréable ou une baisse de performance.
Anxiété de performance
Grâce à ses qualités neurostimulatrices et neuroprotectrices, ainsi qu’à ses capacités de régulation psychoaffective, la pratique musicale aide à acquérir et à conserver un bon équilibre mental, ce qui a été démontré par de nombreuses recherches scientifiques et peut être expérimenté de manière empirique par les musiciens. Malgré tout, elle ne peut prémunir de tous les troubles, et des causes connexes peuvent même la rendre néfaste, surtout lorsqu’un interprète ne réussit pas à surmonter sa peur de la scène et à se libérer de son appréhension. Cette anxiété de performance musicale peut produire des effets dévastateurs durables : des troubles musculosquelettiques, une augmentation de la tension artérielle, une mauvaise estime de soi, une phobie sociale, une dépression et bien entendu des troubles cognitifs (perte de l’attention ou de la concentration). En guise de prévention, les techniques de relaxation, à l’instar de la technique Alexander ou de la méthode Feldenkrais, sont préférables aux médicaments générant des effets secondaires indésirables, voire dangereux et addictifs.
Pression sur les étudiants
De mauvaises pratiques psychologiques peuvent s’acquérir très tôt, lorsque par exemple l’enfant doit se conformer à des attentes trop impatientes ou trop pointilleuses de ses parents ou de ses professeurs, voire à des pressions qui peuvent aller jusqu’à une véritable maltraitance. Des effets négatifs ultérieurs peuvent en résulter, que ce soit un dégoût du métier de musicien, un sentiment de ne jamais être suffisamment à la hauteur, des états dépressifs ou des addictions. Encore peu abordé, ce sujet fait présentement l’objet d’un intérêt croissant, et nous aurons l’occasion d’y revenir très prochainement, la protection de la santé des musiciennes et des musiciens constituant une des grandes préoccupations de l’USDAM.