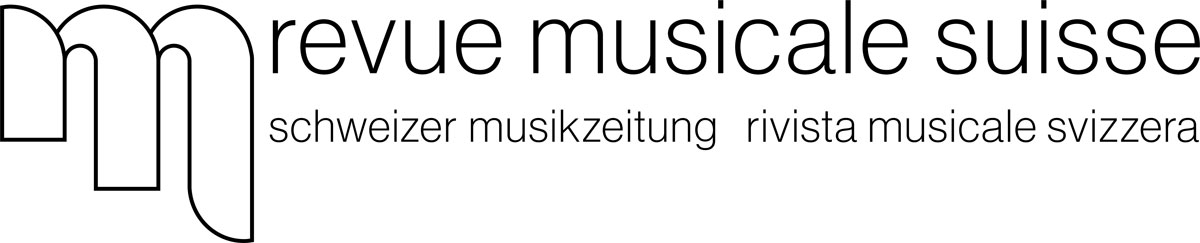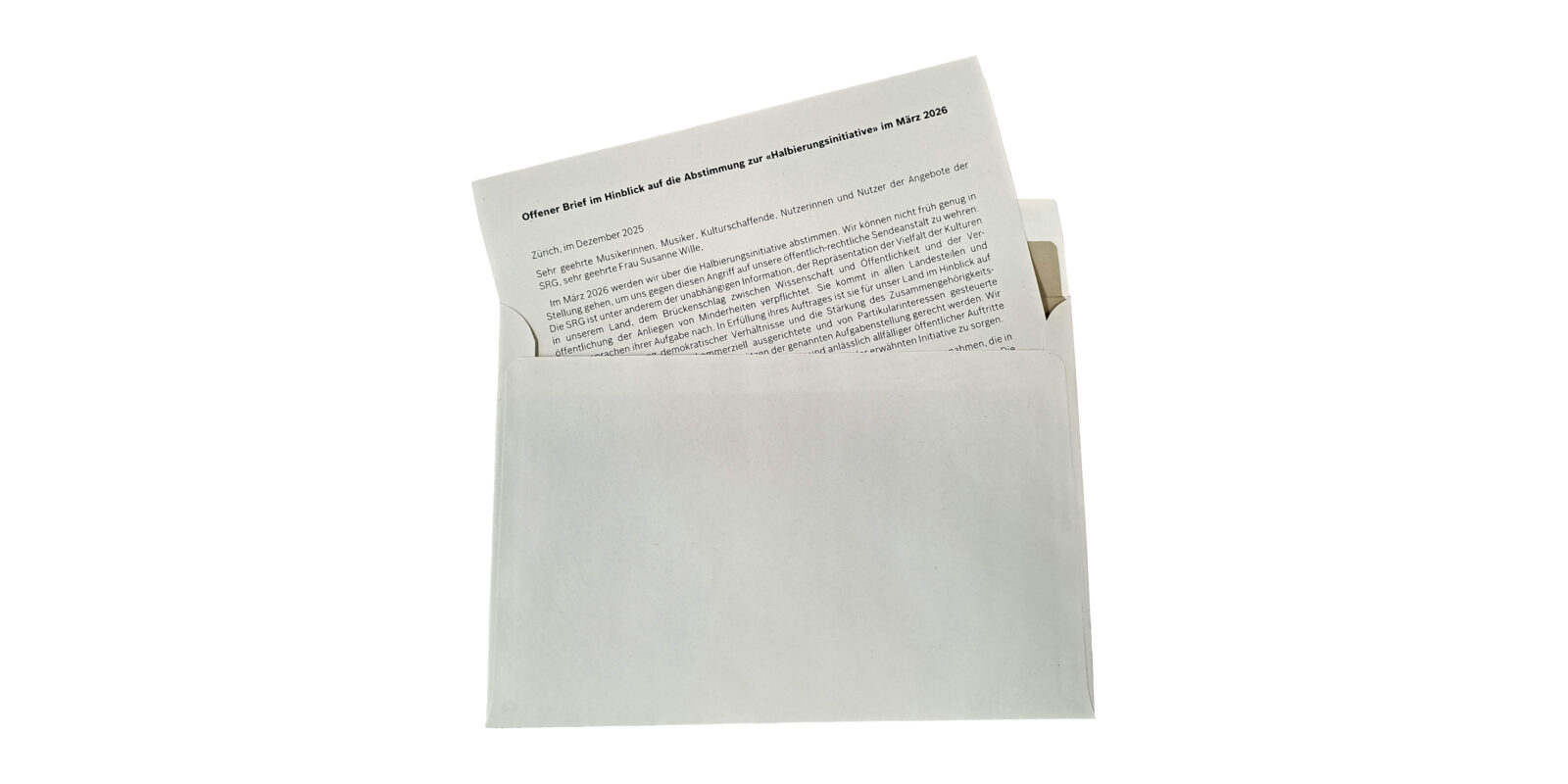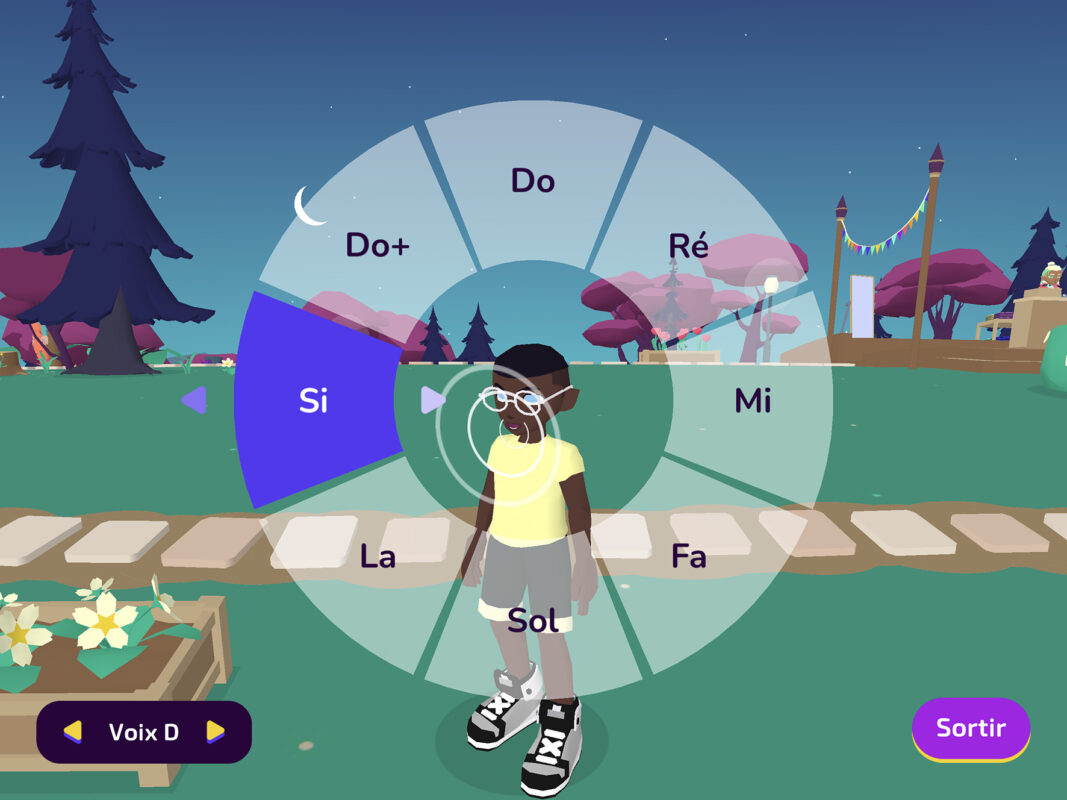« Vies de musiciennes extraordinaires »
Un témoignage d’Adele Posani sur l’enseignement de la musique en Palestine. « La musique comme masseuse de l’âme, qui aide à faire émerger les émotions, à ne pas se fermer, à écouter et à communiquer. »
L’entretien que j’ai réalisé en janvier est avec Adele Posani, professeur de flûte, musique de chambre, théorie musicale, ensemble de cuivres et responsable du département des cuivres à l’Edward Said National Conservatory of Music (ESNCM) en Palestine, dans les sites de Jérusalem, Bethléem, Ramallah et Naplouse. Cet entretien a eu lieu pendant la trêve de la guerre entre Israël et le Hamas, en janvier 2025.
Malheureusement, lorsque la situation a dégénéré ces derniers mois, Adele a dû retourner en Italie, tout en continuant à maintenir, dans la mesure du possible, des contacts avec les musiciens et étudiants en Palestine.
Après plusieurs appels téléphoniques au cours des dernières années, de plus en plus dramatiques, il m’a semblé utile de donner une voix aux événements et au défi de rendre possible la poursuite des études musicales, comme source de dialogue et de culture entre les peuples.
Adele, elle, a vécu ces événements et les vit sur sa propre peau, et nous raconte tout cela de manière passionnée et détachée à la fois, relatant le quotidien de son travail et de ses déplacements, nous permettant de nous faire une idée de ce qu’était (oui, car on ne sait pas aujourd’hui ce qui restera de tout ce qu’elle raconte) son travail.
J’ai rencontré pour la première fois Adele Posani en 2014 au Conservatoire de la Suisse italienne, à Lugano, où elle a été ma collègue pendant 3 ans dans le cadre du cours « Musique de chambre avec méthodologie et pratique ».
Dès le départ, elle s’est révélée être une personne-musicienne-flûtiste vive, intéressée par tout ce qui est nouveau, non conventionnel, dans la musique comme recherche de soi et d’un rôle dans la société, ainsi que par les parcours pédagogiques possibles qu’elle pouvait offrir.
Après avoir terminé avec succès ses études académiques, elle est partie en Amérique du Sud (Bolivie) puis, entre 2015 et 2020, elle a remporté le concours pour l’Edward Said National Conservatory of Music (ESNCM). Depuis 2020, elle est professeur de flûte à l’Académie Barenboim Said, à Ramallah, en Palestine.
Adele Posani, pourrais-tu nous résumer comment était organisé l’enseignement de la musique en « territoire palestinien » avant l’éclatement de la nouvelle guerre le 7 octobre 2023 ?
Je précise que je ne suis jamais allée dans la bande de Gaza, car il est devenu très difficile d’obtenir des permis après l’opération « Bordure de Protection » durant l’été 2014, et je suis arrivée en Palestine en septembre 2015. En ce qui concerne la Cisjordanie, ou « West Bank », je peux dire que les principales écoles de musique qui enseignent aussi, ou exclusivement, la musique classique sont l’Edward Said National Conservatory of Music, la fondation Barenboim Said, Kamandjati, l’association Sounds of Palestine. Il y a aussi Amwaj, un chœur de voix blanches qui mène des activités principalement à Hébron et Bethléem.
Quels genres de musique enseigne-t-on ?
En plus du conservatoire, il existe de nombreuses autres écoles de musique où l’on enseigne principalement la musique arabe : donc l’oud, le tabla ou les percussions en général, le buzuq, le qanoun, le nay, le chant, mais aussi la clarinette, très présente dans la musique arabe, et le violon, qui est accordé en Sol3, Ré4, Sol4, Ré5.
Ces écoles sont plus petites et moins connues que celles que j’ai mentionnées précédemment, mais elles jouent évidemment un rôle crucial pour maintenir vivante la tradition musicale palestinienne.
La musique traditionnelle, tout comme la danse traditionnelle, la Dabke, sont très demandées lors de toutes sortes de cérémonies, mariages, fiançailles, célébrations diverses, y compris pour des personnalités qui sortent de prison et retournent chez elles.
En ce qui concerne l’enseignement de la musique classique, l’ESNCM (Edward Said National Conservatory of Music) est sans aucun doute l’institution musicale la mieux implantée sur le territoire. Jusqu’en 2020, elle comptait cinq sites principaux (Jérusalem, Bethléem, Ramallah, Naplouse, Gaza), plus une structure à Birzeit, un village où se trouve la plus grande université de Palestine, où se déroulaient les plus grands projets, et en plus, elle organisait ce qu’on appelait des « programmes de sensibilisation » où certains enseignants d’instruments se rendaient à Hébron, à Jéricho, à Jénine pour mener des activités de musique pédagogique ou même des cours réguliers d’instruments.
D’après ce que j’ai pu voir personnellement et d’après les récits de mes collègues qui étaient là avant mon arrivée, je peux dire que cette institution a très bien fonctionné entre 2010 et 2020.
Cela semble assez complexe à première vue, organiser un système aussi ramifié. Comment cela fonctionne-t-il ?
Évidemment, ayant travaillé là pendant 5 ans à plein temps avec des rythmes de travail très intenses, je connais aussi les problèmes qui affligeaient cette école, internes et externes. Les problèmes internes sont d’ordre organisationnel, de communication, de relations interpersonnelles, et autres, dus au fait que l’institution avait un personnel administratif restreint, tandis que le personnel académique était imposant, composé de Palestiniens et d’étrangers venant de diverses parties du monde (beaucoup d’Européens, mais aussi des Australiens, Russes, Sud-Américains), pour un total d’une cinquantaine de professeurs répartis sur cinq sites différents.
On enseignait différents styles de musique, en plusieurs langues, et il fallait discuter de nombreux détails très variés, comme le répertoire orchestral ou encore le système d’enregistrement des présences. Je pense que toute personne ayant travaillé dans un environnement scolaire peut imaginer les problèmes que cela peut engendrer.
Quant aux problèmes logistiques, je pense qu’il est difficile de se rendre compte, depuis ici, de ce que cela signifie gérer une institution de cette taille et répartie sur un territoire sous occupation militaire.
Comment te déplaçais-tu ?
Pour donner un exemple : l’accès au site de Jérusalem, bien qu’il soit au cœur de Jérusalem-Est, à quelques pas de la Porte de Damas et de la rue Salah al-Din, étant donné que toute la ville est sous contrôle israélien, avec une annexion de facto, il est illégal pour la plupart des enseignants résidant en Cisjordanie d’y accéder.
Cela signifie, par exemple, que si un professeur de qanoun vient de Bethléem, et qu’il y a une classe de qanoun sans professeur à Jérusalem, ce professeur ne peut pas se rendre à Jérusalem pour couvrir cette classe, simplement parce qu’il n’a pas le permis pour passer le checkpoint.

Comment la situation des déplacements a-t-elle évolué depuis ton arrivée en Palestine ?
Les deux premières années, j’enseignais aussi sur le site de Jérusalem, deux jours par semaine, puis à partir de 2017, Israël a cessé de délivrer des visas pour accéder à Jérusalem et la même procédure qui, les années précédentes, m’avait permis d’obtenir un visa pour traverser les checkpoints, m’a soudainement confinée à la Cisjordanie. J’ai donc dû arrêter d’enseigner à Jérusalem.
Progressivement, il est devenu de plus en plus difficile d’obtenir des visas et des permis même pour les internationaux : au début, il suffisait de renouveler le visa touristique simplement en sortant et entrant du pays, puis cela est devenu risqué car on risquait une interdiction d’entrée dans le pays pour dix ans ; avant, une lettre de ton consulat te permettait d’obtenir un visa à entrées multiples, puis cela est devenu un permis de résidence uniquement en Cisjordanie, qui expire dès que l’on quitte le pays. Ce sont là les problèmes auxquels on est confronté après avoir trouvé un musicien qui accepte de travailler dans un endroit aussi difficile, ce qui n’est déjà pas une tâche facile. Continuité pédagogique ? Impossible.
Et pendant le Covid, que s’est-il passé ?
Avec le Covid et les restrictions sur les voyages internationaux, la situation pour le Conservatoire a empiré, tous les échanges qui avaient lieu pendant les projets ont été interrompus, puis en 2021 il y a eu l’opération « Gardiens des Murailles » (mai-juin) et à partir de ce moment-là, la situation a été un crescendo de tensions, qui ont fini par mener à la guerre que nous voyons aujourd’hui.
Qu’est-il advenu des projets d’orchestre, de musique de chambre et autres ?
En conséquence des restrictions, il n’y a pas eu l’opportunité, même pour une école comme l’ESNCM, de reprendre les projets comme avant. Cependant, des problèmes similaires se rencontrent dans toutes les autres écoles : elles subissent les limitations imposées par l’occupation sous différentes formes.
Même pour la Fondation Barenboim-Said ?
Oui. Bien qu’elle soit née avec l’Orchestre West-Eastern Divan, un orchestre formé de musiciens israéliens et palestiniens, c’est maintenant une école de musique basée à Ramallah, où l’on enseigne uniquement la musique classique occidentale.
La Fondation se présente toutefois encore comme le seul pont pour les jeunes musiciens palestiniens qui souhaiteraient poursuivre une carrière musicale et étudier en Europe, étant bien connectée avec l’Académie Barenboim Said de Berlin et la Fondation Barenboim Said de Séville. Il y a aussi Kamandjati et Sounds of Palestine, des écoles qui se consacrent plus à la vulgarisation qu’à la formation de haut niveau, mais qui cherchent également à mener des « programmes de sensibilisation ».
Dans les différents sites où tu as travaillé pour l’Edward Said National Conservatory of Music, on enseigne plusieurs styles de musique, parmi lesquels la musique classique « occidentale » n’est qu’un des nombreux genres représentés. Comment t’es-tu sentie dans cet environnement, que je suppose très stimulant ?
Oui, on enseigne à la fois de la musique classique occidentale et de la musique arabe. Dans les cours de théorie musicale, les deux sont enseignées, et le répertoire pour les activités d’ensembles (ensemble de cuivres, orchestre à cordes, orchestre symphonique et chœur) est presque toujours mixte, ou dépend de celui qui gère l’ensemble.
On entre facilement en contact avec la musique arabe, la partie instrumentale, surtout avec la flûte, mis à part quelques limitations pour les quarts de ton, est très intuitive, et on joue surtout des chansons avec une structure reconnaissable.
Les chanteurs, des professionnels aux étudiants, sont ceux qui m’ont le plus impressionnée : la recherche expressive de la voix dans la musique arabe est très différente de celle de la musique occidentale, et j’en suis restée fascinée.
Presque dans chaque situation, dans chaque groupe d’amis, de n’importe quel âge, il y aura toujours quelqu’un qui chante, qui aime chanter pour les autres, et cela crée de nombreuses occasions d’écouter l’esthétique de la voix (surtout pour ceux qui ne comprennent pas le texte).
As-tu dû adapter ou élargir tes connaissances et éventuellement ta formation musicale depuis que tu es entrée en contact avec ces différents genres ?
A posteriori, je sens que je n’ai pas appris assez, que j’aurais pu approfondir beaucoup plus. J’ai écouté beaucoup de musique arabe, tant en concert qu’en écoutant les grands classiques, comme Fayruz ou le Trio Jubran, surtout par curiosité, plus que par nécessité. Plus que tout, il m’est arrivé de jouer et d’enseigner la musique arabe sur le terrain, individuellement ou en ensemble, et c’est ainsi que j’ai appris et intégré mes connaissances, de la manière qui me semble la plus naturelle.
Comment ta communication avec les étudiants et dans ta vie quotidienne a-t-elle évolué au fil des années, en rapport avec les langues et la culture ?
J’ai étudié l’arabe pendant quelques mois, mais je dois avouer que c’est une langue assez difficile et je n’ai pas eu la persévérance. La communication n’a cependant jamais été particulièrement difficile avec les étudiants, sauf lorsqu’on est passés à l’enseignement en ligne pendant la pandémie. Dans ce cas, ayant annulé presque toutes les autres formes de communication non verbale, la langue est devenue un facteur beaucoup plus important.
Quant à la vie quotidienne, j’ai appris petit à petit l’arabe dont j’avais besoin et j’ai continué. De plus, à Ramallah, je crois que c’est plus qu’ailleurs en Palestine (à part Bethléem en raison du tourisme), la plupart des gens parlent suffisamment bien l’anglais pour pouvoir communiquer.
Quel aspect de la vie et de la culture du Moyen-Orient t’a le plus « attirée » ?
En ce qui concerne l’aspect culturel, je peux dire que l’une des expériences qui m’a le plus rapprochée des étudiants a été de pratiquer le Ramadan, le jeûne jusqu’au coucher du soleil pendant 30 jours : c’est une expérience très gratifiante, on partage la souffrance, le stoïcisme et la satisfaction de boire et de manger ensemble à la fin de la journée.
Y a-t-il des endroits où les instruments, que l’on voit dans les vidéos que tu m’avais envoyées avant 2023, ont été mis à l’abri de la destruction actuelle (janvier 2025) ?
Je n’en suis pas sûre, mais je ne crois pas. Il semble que le site de Gaza ait été touché, mais pas complètement détruit.
Je ne sais pas ce qu’il est advenu des instruments, je crois qu’ils sont encore là, mais dans quel état, on ne peut pas le savoir.
Nous devons attendre que quelqu’un puisse y accéder en toute sécurité pour vérifier.
Et s’il y a encore des instruments dans un état réparable, comment vont-ils être réparés ?
Et s’ils les réparent, où vont-ils les mettre ?
Pas dans les tentes, c’est sûr !
Je ne crois pas qu’il soit facile de se rendre compte de la quantité de problèmes logistiques causés par la dévastation.
Malheureusement, je crains que même les instruments qui pourraient être sauvés, ne pouvant être entretenus et n’ayant pas de lieu pour être stockés, n’aient pas beaucoup d’espoir. Si nous devons attendre que les décombres soient nettoyés pour accéder aux pianos, je crains qu’il ne soit trop tard.
Ces jours-ci (début janvier 2025), on parle d’une trêve de deux semaines, dont tout le monde espère qu’elle sera suivie d’un cessez-le-feu définitif (!). Après toute cette destruction, penses-tu qu’il reste encore quelque chose de vivant, des personnes qui pourraient contribuer à la reconstruction de la Palestine, qui soutiendraient encore l’utopie de la paix, au moins en faisant de la musique ensemble ?
En attendant, pendant ces mois de guerre, la musique a continué d’être jouée à Gaza.
À Khan Younis, un groupe conséquent d’enseignants du Conservatoire s’est formé, et ils ont commencé des activités de groupe, principalement du chant, bien que, d’après les vidéos que j’ai vues, ils n’avaient qu’une guitare, un violon et quelques ouds (luths arabes). Cela montre que l’envie de faire de la musique ne peut pas mourir ; tant qu’il y a des gens, il y a de la musique.
Je ne sais pas ce que signifie la paix dans cette terre, je ne sais pas ce qu’elle pourrait signifier dans ce contexte.
Cependant, je pense que, durant et après de grands traumatismes, la musique est le masseur de l’âme, celle qui aide à libérer les émotions, à ne pas se refermer, à écouter et à communiquer.
Je crois donc que la musique sera essentielle, mais je n’ose rien prédire sur l’avenir de Gaza, car je ne pense pas être capable de saisir l’ampleur de la destruction.
Penses-tu continuer ton travail en Palestine si et quand cela sera de nouveau possible ? Ou plutôt chercher à créer quelque chose en Italie ? Ou repartir pour de nouveaux projets ailleurs ?
Pour l’instant, je pense rester en Italie, bien sûr avec une forme d’intégration, même si je cherche encore à comprendre laquelle. J’ai eu l’occasion de vivre des expériences très différentes en Palestine et je sais que j’aime et que je m’intéresse à travailler avec les enfants et les adolescents, surtout en groupe, et j’aimerais essayer d’intégrer ces expériences dans un projet similaire en Italie.
Merci Adele, pour ton témoignage et ton récit passionné !
Merci à vous !
Note de Omar Zoboli.
Je remarque maintenant que le temps des verbes, dans cette interview, saute constamment du présent à l’imparfait : ce signal montre en fait combien il est difficile de maintenir un présent stable (du moins temporairement) dans une situation de vie aussi précaire, et surtout on comprend à quel point le présent et le passé s’insinuent dans chaque perception de l’instant quotidien.
Adele Posani

…est née à Rome en 1988. Elle commence à étudier la flûte dès l’école secondaire, puis elle s’inscrit au Conservatoire d’Aquila « A. Casella » et obtient son diplôme sous la direction du M° Paolo Rossi.
Elle a ensuite participé à des Masterclasses avec des maîtres tels qu’Oliva, Tabballione, Boghino, Riolo, Ancillotti, Pretto, Persichilli, Wye, Rien de Reede, Thies Roorda, Campitelli, Bennett.
Elle a suivi le Biennium de Spécialisation en Flûte au Conservatoire « G. Frescobaldi » de Ferrare, où elle a obtenu son diplôme avec les plus grands honneurs en février 2013. Elle a ensuite brillamment obtenu un Master of Arts en Pédagogie Musicale (2014) et un Master of Arts en Performance Musicale (2015) au Conservatoire de la Suisse italienne sous la direction du M° Mario Ancillotti.
En tant que flûtiste principal, elle a également collaboré avec l’Orchestre du Conservatoire de la Suisse italienne, l’Orchestre du Conservatoire de Ferrare, l’Orchestre de Cuivres du Tessin, sous la direction de chefs tels que M° Veleno, M° Neschling, M° Verbitzky, M° Venzago.
Elle joue avec le trio Nuove Triospettive (première exécution suisse du trio « Algoritmo Intuitivo » de A. Portera) et avec le guitariste Pedro López de la Osa, avec lequel elle a remporté le prix de musique de chambre de Santiago de Compostelle, et avec lequel elle a donné des concerts en Italie, en Espagne et en Palestine.
Entre 2015 et 2020, elle a été enseignante de flûte, de musique de chambre, de théorie musicale, d’ensemble de cuivres et responsable du département des cuivres à l’Edward Said National Conservatory of Music (ESNCM) en Palestine, dans les sites de Jérusalem, Bethléem, Ramallah et Naplouse. Depuis 2020 et jusqu’à aujourd’hui, elle est professeure de flûte à l’Académie Barenboim Said, à Ramallah, en Palestine.