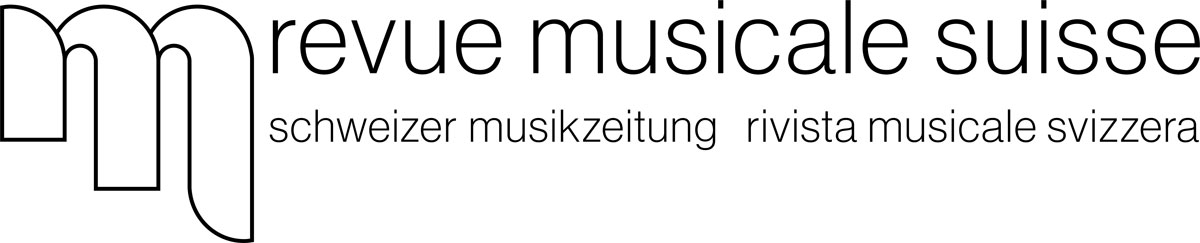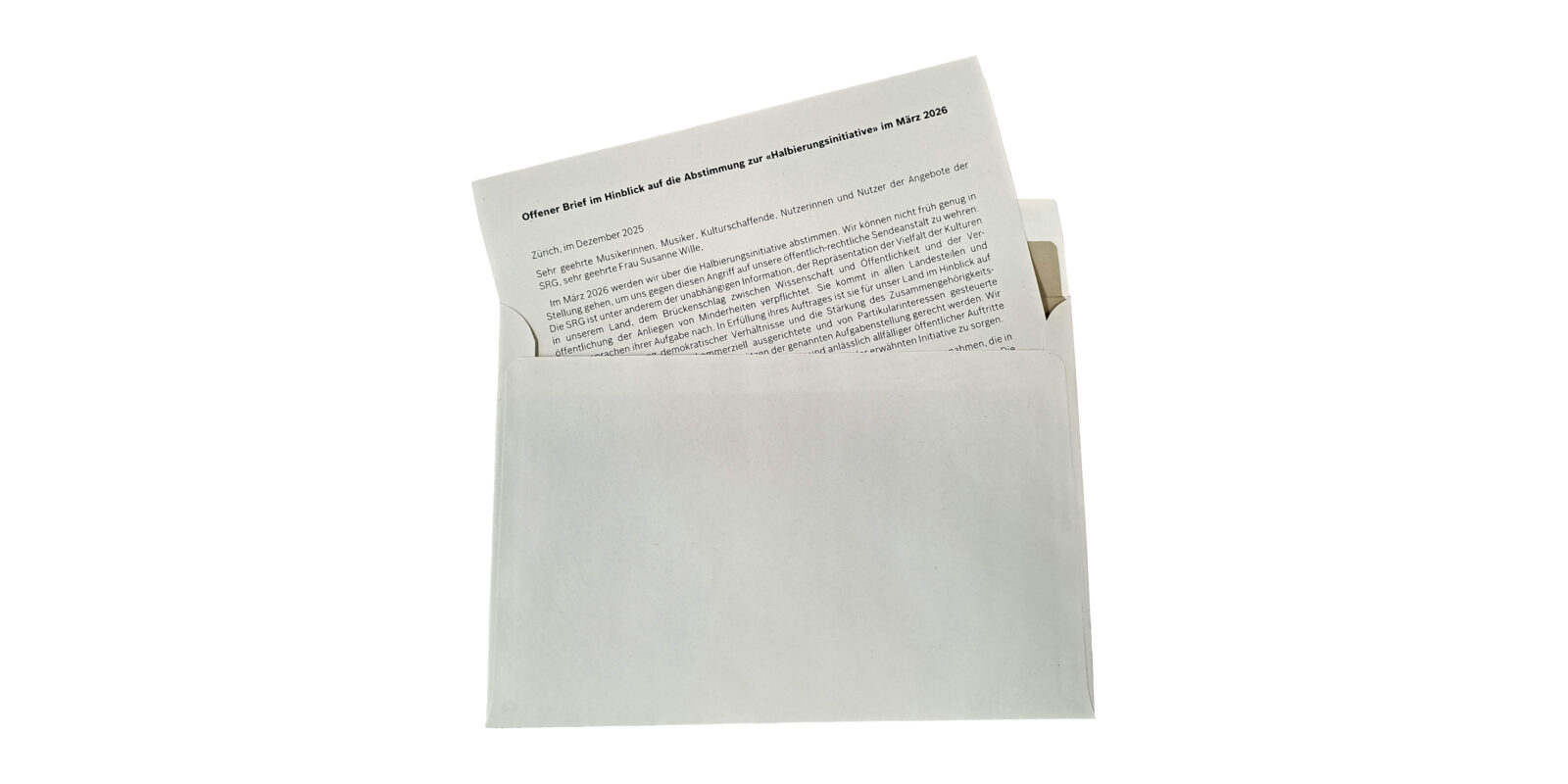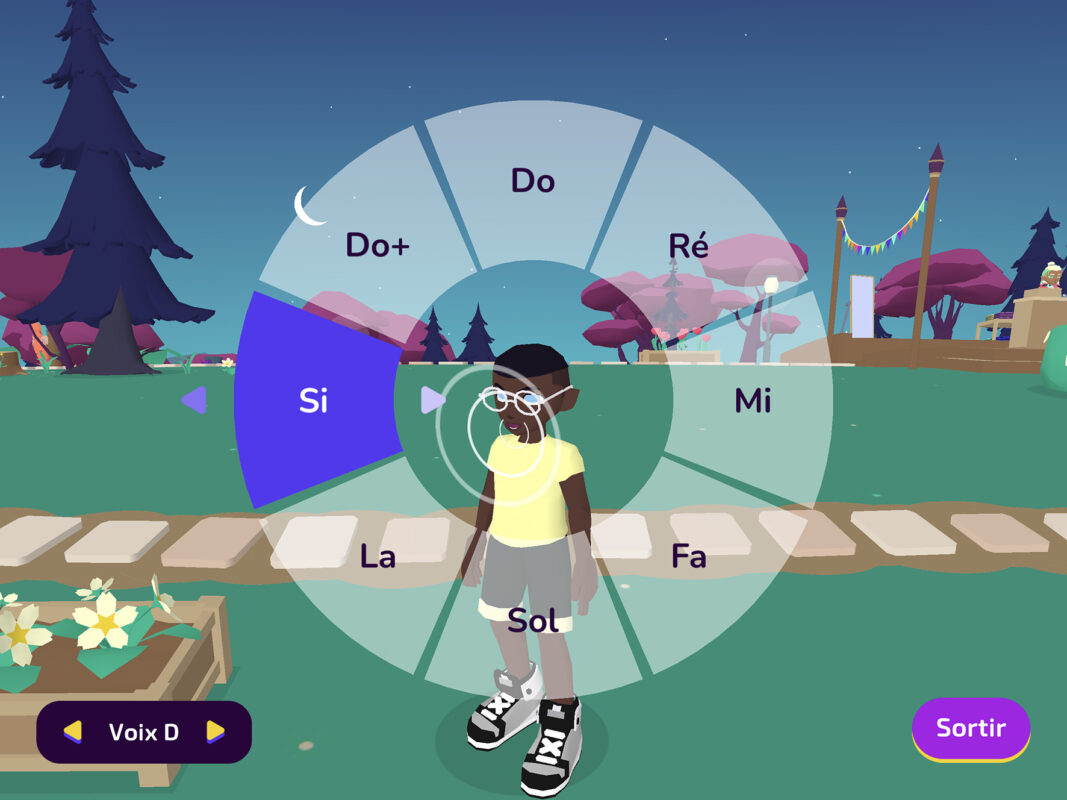Farnaz Modarresifar – sonorités contemporaines du santour
Virtuose du santour et compositrice franco-iranienne, Farnaz Modarresifar propose un univers résonant et développe un langage contemporain original pour son instrument tout en montrant son attachement à la tradition. Entretien.

Photo : Farid Modarresifar
A Genève, le festival Archipel a consacré un concert-portrait à Farnaz Modarresifar lors de son édition 2025.
Farnaz Modaressifar, qu’est-ce qui fait la particularité de cette cithare sur table persane appelée santour ?
Je peux dire que c’est surtout la résonance de cet instrument qui le rend particulier, car il n’a pas d’étouffoir, contrairement à la cithare chinoise par exemple. Je dis souvent que l’art d’interpréter le santour, c’est l’art d’interpréter les résonances. En ce qui me concerne, je travaille beaucoup sur les couches harmoniques et résonantes de cet instrument qui le caractérisent le mieux. Le santour classique sur lequel je joue est composé de 18 chevalets, 72 cordes, et une table d’harmonie. La caisse de résonance est traditionnellement fabriquée en noyer, dont j’aime particulièrement la sonorité, mais on peut aussi la trouver en d’autres essences. Les cordes sont frappées avec deux baguettes légères, ce qui caractérise le mode de jeu spécifique de cet instrument. Le santour, comme la plupart des instruments classiques persans, n’est pas puissant, et à mon avis, toute sa richesse se déploie dans cet aspect intimiste. C’est pourquoi certaines de mes musiques demandent une écoute très attentive.
Vous créez des œuvres bien encrées dans le 21e siècle et composez pour tout type d’effectif, allant de l’instrument ou voix en solo à l’orchestre de chambre. La pianiste Maroussia Gentet du Collectif G, dit de vos œuvres qu’elles « explorent beaucoup l’aspect tragique de la résonance »…
Nous avons plusieurs collaborations avec Maroussia Gentet en tant que pianiste et membre du collectif G, un groupe de musiciens et musiciennes dont j’admire beaucoup la qualité de travail et la présence scénique. C’est intéressant qu’elle ait retenu cet aspect « tragique » de mon travail en tant qu’interprète, mais aussi en tant que compositrice. Je pense que les histoires personnelles et sociales que j’ai vécues en Iran et en France, cette dualité culturelle qui me définit, ainsi que la pensée littéraire qui est fondamentale à la musique persane, forment d’une certaine façon le regard poétique et dramatique que j’ai acquis en tant que créatrice. A travers la culture musicale classique persane dans laquelle j’ai baigné dès l’âge de 6 ans, et le parcours académique que j’ai suivi à Téhéran, je suis en permanence liée à et touchée par la littérature et la poésie persanes. Cet aspect dramatique et parfois tragique est donc toujours présent, et m’inspire dans mon travail. On peut même parler d’une passion personnelle.
Vous êtes sensible à l’univers des sons mais aussi à l’univers de la littérature. Depuis votre adolescence, vous vous êtes particulièrement intéressée à la mythologie antique persane ainsi qu’à l’analyse des rêves proposée par Freud et Jung. Vous écrivez vous-même des poèmes à partir de vos rêves…
Oui, dès l’âge de 19-20 ans, j’ai commencé à m’intéresser beaucoup aux études psychanalytiques de Freud et de Jung, ainsi qu’aux transcriptions et à l’interprétation des rêves. Le fait de rentrer dans l’inconscient de l’autre m’a toujours passionné. Il faut dire qu’en Iran, ce n’était parfois pas facile de trouver les traductions des entretiens de Freud. Mais ma maîtrise de l’anglais et du français m’a permis d’accéder à plusieurs sources dans ces domaines, et de compléter mes lectures. A la même époque, je lisais aussi énormément sur la mythologie antique persane. Tous ces livres, y compris les histoires et mythes indo-américains, m’ont accompagné jusqu’à aujourd’hui. Puis j’ai commencé à écrire ce que j’appelle une sorte de « livre rouge », rassemblé en deux volumes et basé sur les transcriptions de mes rêves. Un petit recueil en persan a d’ailleurs été publié en Iran, et une traduction française est prévue…
Dans quelle mesure ces lectures inspirent-elles votre musique ?
Que ce soit des romans, de la poésie ou d’autres genres littéraires, elles ont une influence directe sur mon travail de musicienne. Le domaine de la poésie est, à mon avis, l’état le plus pur de l’inconscience d’un écrivain. En général, j’écris les textes de mes musiques lorsque je compose moi-même. Je me base donc sur l’ambiance sonore des textes que j’imagine la plupart du temps d’après mes rêves…
Le chant constitue l’un des piliers de la musique traditionnelle persane. Il est aussi présent dans certaines de vos compositions…
Absolument. En fait, l’une des règles fondamentales de la musique classique persane, dite aussi musique savante, que je pratique depuis mon enfance, est qu’elle est étroitement liée à la poésie et à la littérature classique persane, véhiculées par le chanteur ou la chanteuse. Le chant et la voix jouent donc un rôle essentiel dans cette musique, basée sur sur l’ambiance des poésies choisies. Dans certaines de mes pièces, j’essaie de réunir la voix et l’instrument comme un seul corps… Ma musique se base autant sur l’étude des timbres de la musique contemporaine occidentale que sur les contours mélodiques et modaux de la musique traditionnelle persane, sans pour autant composer, par exemple, des tasnifs sur les modes persans, qui est une pratique très connue chez les interprètes de musique traditionnelle. Il m’arrive d’emprunter parfois quelques vers de grands poètes classiques, tels qu’Hafez et Ferdowsi, ou de grandes figures de la poésie contemporaine comme Forough Farrokhzad, en les citant dans la partition, sans qu’ils soient récités ou chantés. Cela permet à l’interprète de saisir la direction vers laquelle s’oriente la musique…
Après des études au Conservatoire national de musique et à l’Université de Téhéran, vous avez poursuivi une formation approfondie en composition à l’Ecole Normale de Musique de Paris− Alfred Cortot, au Conservatoire de Boulogne Billancourt, puis une formation en improvisation et création musicale à l’Université de Paris VIII. Comment votre parcours vous a-t-il mené à l’univers de la composition ?
Un élément déclencheur déterminant a eu lieu en 2009 : lors d’un voyage académique en Allemagne, j’ai eu l’opportunité d’écouter pour la première fois à la Philharmonie de Cologne une interprétation d’Atmosphères de György Ligeti. Ce fut pour moi une découverte ! Ce premier contact avec la musique contemporaine a vraiment éveillé ma curiosité. A tel point qu’à mon retour en Iran j’ai commencé à suivre des cours de composition, sans avoir réellement l’intention de devenir compositrice. Pendant à peu près deux ans, ma participation à l’ensemble exploratoire de mon professeur Kiavash Saheb Nassagh m’a permis d’explorer la musique contemporaine avec le santour. C’est à ce moment-là que j’ai commencé à répertorier et à travailler sur les modes de jeu augmenté ou contemporain, sur la question du timbre et sur le mélange sonore de cet instrument au sein d’un ensemble ou d’un orchestre. Après avoir obtenu une licence à l’Université de Téhéran, emportée par une passion, j’ai pris la décision de me perfectionner en composition en France, pays que j’ai choisi surtout pour une question d’esthétique musicale. Mais l’histoire d’une relation culturelle forte entre la France et l’Iran a également joué un rôle dans ce choix. L’improvisation dans le style contemporain m’a toujours profondément fasciné et c’est la raison pour laquelle j’y ai aussi poursuivi un master en improvisation.
Pour le Festival Archipel, vous avez proposé une sélection de vos œuvres inspirées de vos poèmes et textes. C’est un programme qui permet de tracer les contours de votre recherche. Il y a des pièces écrites que vous interprétez avec l’Ensemble Recherche, mais aussi des improvisations solos ou collectives. Comment avez-vous pensé la dramaturgie de ce programme ?
Au départ, le programme était le fruit de contraintes purement matérielles, notamment en ce qui concerne l’instrumentation, car le piano est présent dans quasi toutes mes pièces, mais le festival ne disposait pas de piano pour ce concert. Avec les musiciens de l’Ensemble Recherche, nous avons donc repensé la dramaturgie et le choix des œuvres, compte tenu d’un effectif orchestral restreint pour le festival. Le programme comporte des pièces écrites, composées au cours des dix dernières années comme : Le soleil seulement le soleil pour violon solo (2018), Gabbéh pour alto et santour (2019), La pêcheuse de perles – flûte et clarinette (2015), Che si può fare – voix et santour (2015)… Il inclut aussi des improvisations inspirées de Balade Oniriques (2022), qui est une pièce que j’ai créée à l’origine pour l’Orchestre de Radio France. Il s’agit d’une suite de miniatures basées sur mes rêves et mes poésies. D’autres improvisations sont basées sur des textes du grand poète mystique persan Farid al-Din Attar. La dramaturgie est donc pensée comme une trajectoire musicale et poétique. Le concert est enchaîné et commence par une improvisation solo au santour selon le répertoire classique persan (le radif), afin de permettre au public de découvrir l’identité sonore de cet instrument traditionnel. Puis la diversité des sonorités et des styles de jeu que permet le santour se dévoile au fil des pièces écrites et improvisées… Dès la première répétition, les musiciens de l’Ensemble ont su entrer pleinement dans l’univers et l’état d’esprit de chaque pièce, y compris lors des parties d’improvisation. C’était une très belle expérience pour nous tous !
Comment est née votre collaboration avec l’Ensemble Recherche, reconnu comme l’un des principaux acteurs de la nouvelle musique, et en quoi nourrit-elle vos projets personnels ?
C’est en 2023 que Paul Clift, alors directeur artistique de l’Ensemble Recherche, m’a contactée en vue d’une création avec cette formation. Cette proposition m’avait évidemment rempli de bonheur ! Notre collaboration a mis un certain temps à se concrétiser pour des questions logistiques et financières. Et c’est en 2025 que nous avons eu la chance de pouvoir lancer ce projet ensemble, en tant que lauréats d’Impuls Neue Musik, qui est un fonds franco-germano-suisse pour la musique contemporaine. Nous avons imaginé deux concerts distincts, avec des instrumentations différentes. D’abord dans le cadre du Festival Archipel à Genève, avec la participation de Marie Soubestre à la voix, et une sélection de musiciens de l’Ensemble Recherche. Puis une création pour l’effectif complet de l’ensemble et voix est prévue en décembre prochain à Fribourg. Le travail avec cette formation, mais aussi avec l’Orchestre de chambre de Paris, Ensemble Ars Nova, ou ProQuartet-CEMC, m’apporte un nouveau regard et une richesse d’interprétation, il nourrit énormément ma créativité, mes explorations dans le répertoire chambriste, et mes envies de développer toujours plus le répertoire contemporain pour le santour.