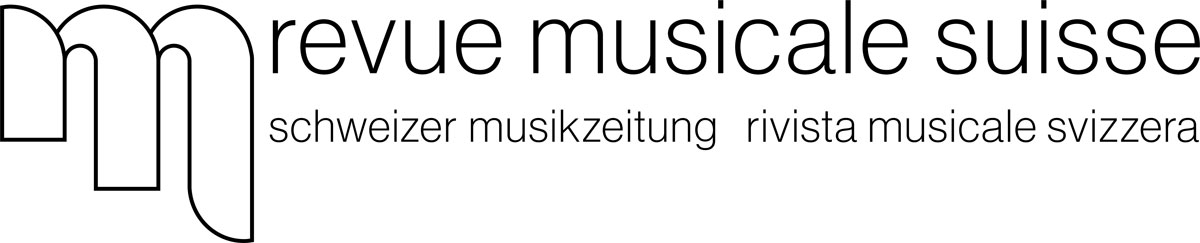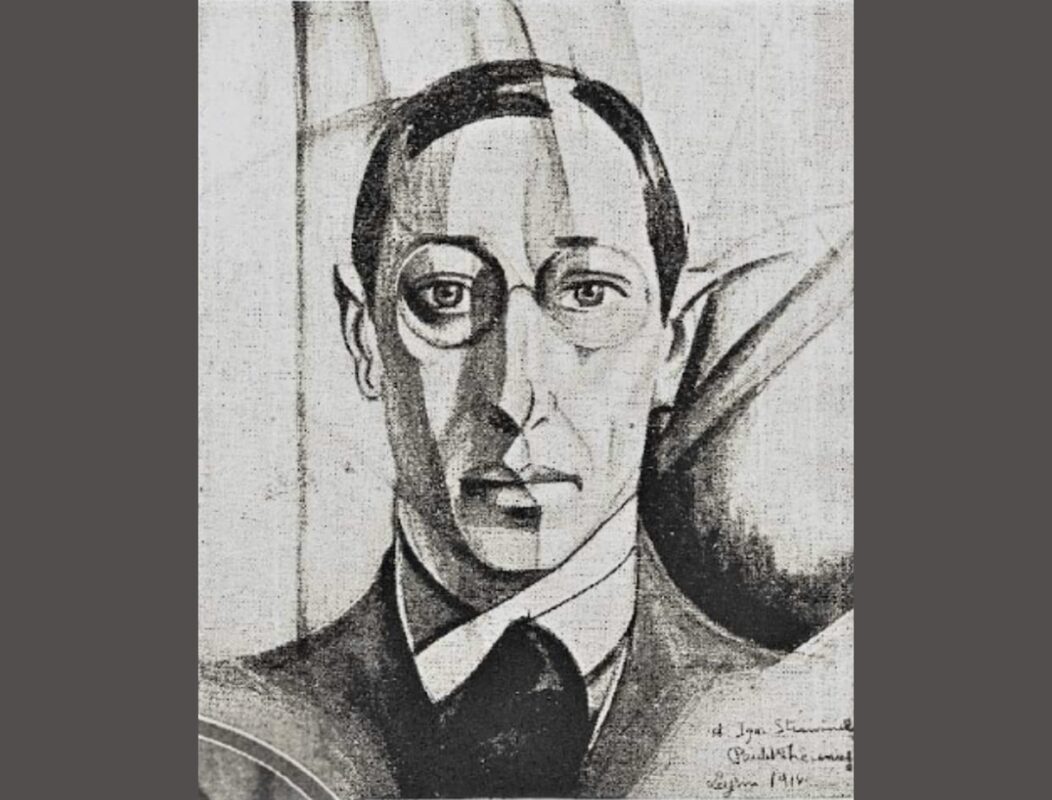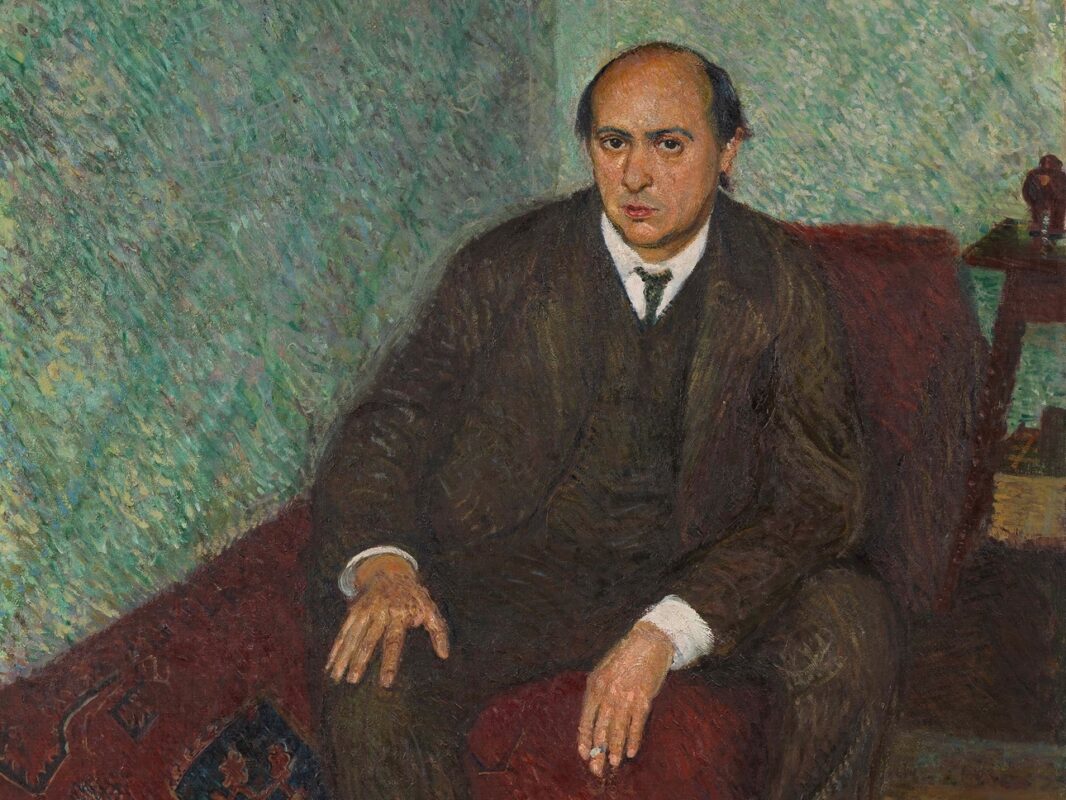Analisi, interpretazione e interazione
Attive da oltre un terzo di secolo, le Edizioni Minerve hanno riservato all'arte di Euterpe un posto essenziale nel loro catalogo.

Tra le recenti pubblicazioni di Minerve c'è un précis d'analyse des formes musicales in cui uno specialista del settore, Claude Abromont, ha scelto un approccio pedagogico basato non su forme astratte e già sintetizzate, ma sulle composizioni stesse, e quindi sulla viva immaginazione sonora dei creatori. Questo viaggio all'interno delle opere non si limita alla descrizione della grande forma, ma analizza tutti gli aspetti sottostanti, dai più elementari ai più complessi - linguaggio, materiali, timbri, fraseologia e funzioni formali - prima di arrivare alla narrazione espressiva musicale, alla sua retorica e ai suoi significati. L'obiettivo è quello di riconoscere la logica del discorso, il modo in cui i materiali sono utilizzati e le ragioni per cui lo sono, così come le funzioni delle diverse sezioni, in modo che l'identificazione della forma diventi una questione ovvia, piuttosto che una ricerca puramente intellettuale di una struttura fissa. Oltre a un'analisi approfondita del Preludio al Pomeriggio di un faunoOltre 150 composizioni, dal Medioevo ai giorni nostri, sono descritte in dettaglio in video di partiture commentate disponibili online.
Dedicato più specificamente allo studio del linguaggio musicale del periodo barocco, il conciso volume di Laurent Fichet segue l'evoluzione dei suoi principi, dalla fine della musica rinascimentale all'emergere della nozione di accordo e all'affermazione della tonalità, seguendo la graduale scomparsa dei modi medievali, per ragioni sia melodiche che contrappuntistiche, a favore esclusivamente dei modi maggiore e minore, nonché la riduzione del numero di gradi armonici utilizzati. Utilizzando spartiti e trattati di musicisti e filosofi dell'epoca e teorie più recenti, il musicologo affronta una serie di argomenti, in particolare l'accordatura e i temperamenti, l'importanza strutturante dei passaggi armonici e la questione della giustificazione della terza minore - quest'ultima ha richiesto molto tempo per essere accettata teoricamente, anche se era già ampiamente utilizzata. È deplorevole, tuttavia, che gli aspetti melodici e ritmici, così come la retorica, non vengano affrontati in modo più approfondito.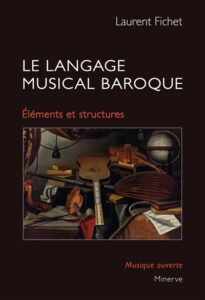
Sotto forma di glossario di una cinquantina di termini, il musicologo Philippe Lalitte offre una sintesi delle conoscenze attuali sulle pratiche di esecuzione musicale occidentale, dal Medioevo ai giorni nostri. Dalla formazione dei musicisti, il loro accesso alle fonti, l'analisi delle partiture, la loro capacità di memorizzazione e la loro salute, alla rappresentazione sul palcoscenico (compresa la programmazione, i rituali del concerto e l'acustica del luogo), la registrazione e la valutazione delle esecuzioni, vengono evidenziate le numerose sfaccettature dell'arte interpretativa, tenendo conto del loro sviluppo storico. Si tratta di nozioni tecniche (come l'altezza, l'accordatura, i temperamenti e gli effetti sonori contemporanei), nozioni estetiche (come la fedeltà al testo o l'autenticità) e nozioni relative all'espressività dell'esecuzione (dinamica, fraseggio, rubato, vibrato), modalità di esecuzione (diteggiatura, pedalata, tremolo) o al grado di inventiva lasciato agli esecutori (cadenza, diminuzione, improvvisazione), o a preoccupazioni recenti come l'uso di strumenti d'epoca e la ricerca sulle pratiche esecutive storiche. Naturalmente, nonostante l'abbondanza di informazioni interessanti e precise, non si può pretendere che l'autore sia esaustivo in un campo così vasto, per cui solo lo studio di alcune scuole pianistiche è oggetto di un capitolo, a scapito di altri strumenti; quanto alla voce "ornamento", essa copre i suoi usi dal gregoriano alla metà del XIX secolo.e secolo senza entrare nel dettaglio, poiché l'ampia bibliografia può rimediare se necessario.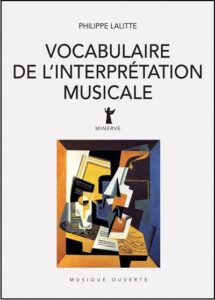
Il dialogo tra le diverse arti è da tempo una passione del mondo culturale, soprattutto negli ultimi decenni. Per secoli, la pittura e la scultura hanno rappresentato la musica solo attraverso cantanti o strumentisti, o attraverso la rappresentazione di strumenti, mentre la musica ha aspettato il Romanticismo per iniziare a esprimere le emozioni provate di fronte a un particolare dipinto, monumento o scultura. D'altra parte, negli ultimi 120 anni le interazioni si sono moltiplicate. Il vento di sperimentazione che soffia dall'inizio degli anni '20 è stato un vero e proprio "colpo di fulmine".e secolo ha avvicinato le arti visive e sonore. Tra gli innumerevoli esempi: le forme musicali sono entrate a far parte del pensiero di pittori come Kandinsky; Kupka ha percepito i ritmi e la temporalità; gli esperimenti cinematografici astratti hanno collegato gli eventi grafici ai suoni; le opere plastiche hanno espresso lo svolgersi del tempo; Messiaen ha avuto un forte senso dei fenomeni di sinestesia; le partiture di Crumb sono diventate veri e propri tableaux; la disposizione spaziale è diventata parte integrante di opere musicali non teatrali; le installazioni sonore hanno attirato l'attenzione degli occhi oltre che delle orecchie. Il compositore Jean-Yves Bosseur utilizza la sua vasta erudizione per esplorare i fruttuosi scambi tra le arti visive e la musica nel corso del XX secolo.e e 21e secoli.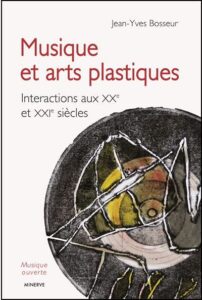
Claude Abromont : Analisi delle forme musicali306 p., € 28,00, Éditions Minerve, Paris 2024, ISBN 978-2-86931-181-7
Laurent Fichet: Il linguaggio musicale barocco. Elementi e struttureseconda edizione, 192 p., € 22,00, Éditions Minerve, Paris 2024, ISBN 978-2-86931-177-0
Philippe Lalitte: Vocabolario dell'interpretazione musicale240 p., € 21,00, Éditions Minerve, Paris 2024, ISBN 978-2-86931-180-0
Jean-Yves Bosseur: Musica e arti visive. Interazioni nel XX e XXI secoloterza edizione, 342 p., Éditions Minerve, Parigi 2024, ISBN 978-2-86931-179-4